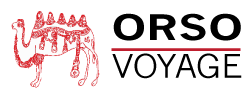La naissance du système actuel
Les systèmes politico-économiques des pays industrialisés, qualifiés de “développés”, semblent historiquement structurés pour préserver les intérêts des classes dominantes. Ce phénomène, illustré par l’écrivain Rance Packard dans son ouvrage The Waste Makers, prend racine dans les bouleversements industriels postérieurs aux deux guerres mondiales. Ces périodes marquent le passage d’une économie de production essentielle à une économie de consommation, où l’objectif devient d’inciter les populations, autrefois centrées sur des besoins primaires comme se nourrir et se chauffer, à consommer des biens superflus.
Les industriels ont cherché des solutions, mais ce ne sont ni les économistes ni les politiques qui ont apporté les réponses, mais plutôt les psychologues et les ethnologues. Ces derniers, grâce à leur compréhension approfondie de l’énergie collective et de l’inconscient sociétal, ont élaboré des stratégies pour conditionner les consommateurs.
John Maynard Keynes, dans son ouvrage La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, souligne que le comportement des consommateurs n’est pas purement rationnel. Il ne repose pas uniquement sur des calculs économiques, mais est fortement influencé par des facteurs psychologiques tels que la confiance, l’incertitude, les habitudes et les émotions. Toutefois, certains chapitres de ses écrits, traitant du rôle fondamental de l’énergie collective, ont été omis par les éditeurs, laissant un vide dans la compréhension complète de sa pensée (2).
La notion d’énergie collective et son rôle dans la gestion des sociétés a été réduite à un concept d’économie comportementale, éclipsant ainsi l’idée de l’énergie humaine comme une réalité essentielle de l’existence. Cette vision, qui s’estompe depuis l’ère cartésienne, a été supplantée par la priorité donnée à la création et au développement d’une culture consumériste, fondement de la société de consommation. Ce projet global visait à transformer tous les aspects de la société : l’art, les loisirs, la culture, le sport, l’éducation, etc. Il s’agissait d’une entreprise d’une échelle sans précédent.
Les États-Unis ont été les premiers à appliquer ce projet, profitant du fait qu’ils n’ont pas été directement ravagés par la Seconde Guerre mondiale. Dans le domaine de l’éducation, par exemple, l’objectif était de concevoir des systèmes d’enseignement standardisés et souvent déconnectés de la réalité humaine. Ce système imposait une seule manière de “s’éduquer”, ignorant les particularités individuelles, tout en créant des universités aux frais prohibitifs, n’accessibles qu’à une élite minoritaire.
Dans le sport et les loisirs, le projet consistait à fabriquer des stars et des célébrités. Ces figures servent de modèles que le public cherche à imiter, aspirant à leur ressembler ou à s’identifier à elles. Cette stratégie repose sur deux besoins fondamentaux de l’être humain : d’une part, son besoin de sécurité au sein d’un groupe ou d’un “troupeau”, qui le protège des dangers ; d’autre part, son besoin de se sentir unique, exceptionnel et authentique.
Ce double besoin, enraciné dans l’inconscient humain, a été exploité par ceux qui ont compris son importance pour initier un conditionnement social à grande échelle. Les célébrités deviennent alors des symboles de réussite et d’authenticité, des figures d’identification qui nourrissent le fonctionnement de la société de consommation.
Les principaux traits caractéristiques des célébrités qui ont pour rôle de susciter la fascination du grand public : Un comportement centré sur soi-même, l’égocentrisme amplifié par les attentes de l’industrie du divertissement, les pousse à se concentrer intensément sur leur image et leur carrière, Vie luxueuse, mode de vie fastueux. Cette mise en scène de la richesse contribue à nourrir des aspirations irréalistes chez leurs admirateurs, renforçant la culture du matérialisme.
Les célébrités symbolisent également une existence où les contraintes ordinaires semblent absentes rythmé par une obsession pour leur apparence physique.
Dans le cadre du projet de conditionnement, la création de célébrités par les industries du divertissement joue un rôle crucial. De puissantes machines, comme l’industrie hollywoodienne, ont une influence considérable dans ce processus. Parallèlement, les études sur la psychologie humaine connaissent une expansion rapide, soutenues par le développement de disciplines axées sur le comportement humain, telles que les tests psychométriques, l’analyse comportementale et les recherches en laboratoire. Ces avancées ne sont pas conçues pour servir les individus, mais pour maximiser leur exploitation.
Aujourd’hui, des comportements ou des faits qui auraient autrefois suscité l’indignation ou le scandale passent inaperçus, devenant banals. Cela témoigne d’une manipulation soigneusement orchestrée, où tout est pensé non pas pour améliorer la condition humaine, mais pour en tirer un bénéfice maximal.
Enfin, en quoi l’étude de ces mécanismes peut-elle nous être utile ? Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’énergie collective et son influence sur les sociétés. Dans le domaine de l’économie, de nombreuses théories ont été développées autour du management, de la régulation et d’autres systèmes de contrôle. Cependant, la particularité de cette machine sociale et économique en action est qu’elle est profondément destructrice : elle nuit à la nature, à la psychologie humaine et aux relations humaines authentiques.
Cette machine a ainsi engendré une prolifération de troubles psychologiques et sociaux, tels que les violences, le narcissisme, les divorces, les burn-out et les solitudes. Cela a conduit à une augmentation exponentielle du recours aux thérapies psychologiques. Ces thérapies, souvent axées sur l’usage de substances médicamenteuses, sont largement alimentées par l’industrie pharmaceutique, qui exerce une influence sans précédent dans nos sociétés.
À l’origine, ce projet mondial de conditionnement a été conçu par ceux qui maîtrisaient les mécanismes de l’énergie collective. Leur connaissance approfondie de ces dynamiques leur a permis de manipuler les comportements humains à grande échelle, façonnant une société où les individus, bien que conditionnés à répondre aux impératifs de cette machine, se retrouvent confrontés à des crises existentielles et relationnelles de plus en plus fréquentes.
Une question essentielle se pose : si les psychologues ont contribué à concevoir une telle machine sociale et comportementale, pourquoi ne proposent-ils pas de solutions pour y remédier ? Aujourd’hui, il est devenu banal de faire face à des comportements narcissiques, égocentriques, stressés ou manipulateurs. Ces attitudes sont omniprésentes dans nos interactions quotidiennes, tout comme les souffrances psychologiques telles que l’insomnie, la dépression, les divorces et d’autres troubles affectant notre bien-être.
Tant que nous n’approfondirons pas la compréhension de la nature même de ce conditionnement sociétal, les approches thérapeutiques resteront superficielles. Cela s’applique autant aux pratiques de thérapie énergétique qu’à l’analyse de notre environnement social et des influences qu’il exerce directement sur les individus. Bien que l’on puisse tenter de soigner les personnes une par une, en les “nettoyant” ou en les “purifiant”, cette démarche restera sans fin tant que la machine à produire ces déséquilibres continuera de fonctionner.
Un exemple pertinent est celui de l’infidélité. Celle-ci est souvent liée à une carence énergétique chez des individus qui ne se sentent pas nourris émotionnellement ou spirituellement. Ils recherchent alors des sources d’énergie dans l’enthousiasme et la nouveauté, des besoins qui auraient pu être comblés par des énergies plus saines et équilibrées. Cette situation découle également de la perte des repères fondamentaux liés aux chemins de vie personnels, des notions oubliées dans un monde dominé par une société conditionnée et déséquilibrée.
Deux psychothérapeutes américains, Phil Stutz et Barry Michels, dans leur ouvrage The Tools (3), affirment que les thérapies traditionnelles sur divan, consistant à faire parler les patients pendant des heures de leurs malheurs, sont souvent inefficaces. Selon eux, ces méthodes risquent davantage de raviver les blessures et d’accentuer les complexes. À l’inverse, ils soutiennent que le moyen le plus efficace pour surmonter les problèmes psychologiques réside dans le développement de la créativité.
Cette idée rejoint également les enseignements des chamans mongols, qui considèrent que la créativité est la clé essentielle pour opérer une véritable transformation intérieure. En cultivant cette capacité, les individus ne se contentent pas de gérer leurs souffrances, mais s’engagent dans un processus de régénération et de croissance personnelle. La créativité devient ainsi un outil fondamental pour rétablir l’équilibre et accéder à une vie plus épanouie.
Pour fonctionner dans une énergie équilibrée et retrouver une véritable confiance en soi, il est essentiel de comprendre l’origine et le fonctionnement du système dans lequel nous évoluons. Les oracles mongols enseignent une vérité profonde : il faut parfois s’éloigner de soi pour réellement se retrouver. Cela signifie qu’un détachement temporaire de nos conditionnements et de nos schémas habituels peut permettre une introspection plus claire et authentique.
Ainsi, pour guérir à la fois soi-même et les autres, il est crucial de décrypter la nature du système actuel. Cette compréhension permet d’éclairer le rôle du corps mental, souvent mal perçu. Le mental est fréquemment considéré comme un obstacle ou un perturbateur, mais cette vision est erronée. Le problème ne réside pas dans le mental lui-même, mais dans notre incapacité à l’harmoniser avec les autres dimensions de notre être.
La clé n’est donc pas d’exclure ou de réprimer le mental, mais de cultiver une réflexion juste et alignée. Trouver cet équilibre permet d’utiliser le mental comme un outil précieux, capable de contribuer à notre croissance intérieure, à la clarté de nos décisions et à la construction d’un chemin de vie plus authentique.
Article par Chimegmaa ORSOO, docteur en sciences politiques et Directrice de l’agence ORSO VOYAGE
Annexes :
(1). L’écrivain Rance Packard, connu pour ses analyses critiques des sociétés de consommation, a illustré ce phénomène de manière percutante dans ses travaux, en mettant en lumière les stratégies utilisées par les industries pour manipuler les comportements des consommateurs. Dans son livre emblématique The Waste Makers (Les Fabricants de gaspillage), il explore comment les entreprises ont délibérément créé des besoins artificiels pour inciter les individus à consommer des biens inutiles ou superflus.
Contribution de Rance Packard :
1. Critique de l’obsolescence programmée :
• Packard explique que les entreprises ont adopté des pratiques telles que l’obsolescence programmée, où les produits sont conçus pour devenir rapidement obsolètes ou inutilisables, forçant ainsi les consommateurs à acheter fréquemment de nouveaux produits.
• Cette stratégie va au-delà des besoins réels des individus et vise uniquement à stimuler la croissance économique au profit des industries.
2. Création de désirs artificiels :
• Selon Packard, les entreprises, avec l’aide de psychologues et d’experts en marketing, ont manipulé les émotions et les aspirations des consommateurs pour les persuader d’acheter des produits qu’ils n’auraient jamais envisagé de posséder auparavant.
• Il souligne que cette méthode repose sur des campagnes publicitaires soigneusement conçues pour exploiter l’insécurité, le besoin de statut social et l’appartenance à un groupe.
3. L’impact sur la société :
• Packard démontre comment ces pratiques économiques ont modifié les priorités des individus, détournant leur attention des besoins fondamentaux (se nourrir, se loger) vers des préoccupations de prestige, de confort et de consommation ostentatoire.
• Il avertit également des conséquences environnementales et éthiques de cette surconsommation, qui engendre un gaspillage massif des ressources.
4. Influence des sciences humaines :
• Il souligne que ce tournant vers la consommation débridée n’a pas été le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail concerté entre les industriels et des experts comme les psychologues et ethnologues, qui ont fourni des outils pour comprendre et influencer l’inconscient collectif.
Pourquoi son analyse est percutante ?
Packard ne se contente pas de décrire les faits, mais il les critique avec force, dénonçant une culture économique qui exploite les désirs humains pour maximiser les profits. Son travail reste pertinent aujourd’hui, car il éclaire les mécanismes de manipulation qui sous-tendent encore les stratégies marketing modernes.
(2). 1. L’approche de Keynes sur le comportement des consommateurs :
Dans La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), Keynes défie les théories économiques classiques qui postulaient que les individus agissent de manière purement rationnelle dans leurs décisions économiques. Il avance que les comportements des consommateurs et des investisseurs sont largement influencés par des facteurs psychologiques.
Les principaux facteurs identifiés par Keynes :
• Confiance : La disposition des individus à dépenser ou investir dépend de leur optimisme ou pessimisme quant à l’avenir économique.
• Incertitude : Les décisions sont prises dans un contexte où l’avenir est imprévisible, et les individus agissent souvent sur la base d’anticipations plutôt que de certitudes.
• Habitudes : Les comportements d’achat sont souvent guidés par des routines et des normes sociales.
• Émotions : Des forces irrationnelles, que Keynes nomme “esprits animaux”, influencent les choix, telles que la peur, l’euphorie ou l’envie de suivre les tendances.
2. L’énergie collective dans la pensée de Keynes :
Keynes considérait que l’économie était profondément enracinée dans des dynamiques sociales et culturelles. L’idée d’énergie collective semble se rapporter à un niveau de motivation ou de dynamique sociale qui transcende les choix individuels.
• Rôle de l’énergie collective :
• Keynes aurait exploré comment les forces sociales et culturelles collectives influencent les comportements économiques.
• L’énergie collective, dans ce contexte, pourrait inclure des phénomènes tels que les tendances générales de consommation, les modes, ou l’esprit collectif d’une époque qui façonne les attentes économiques.
3. Suppression des chapitres par les éditeurs :
L’affirmation selon laquelle certains chapitres de l’ouvrage auraient été supprimés soulève plusieurs questions. Voici des éléments de contexte pour comprendre ce qui aurait pu se passer :
• Objectifs éditoriaux :
• Il est possible que des éditeurs aient jugé que certaines parties, notamment celles traitant de l’énergie collective ou de dimensions plus philosophiques, étaient trop spéculatives ou éloignées des préoccupations économiques pratiques.
• Le livre visait à réformer l’économie, et les éditeurs ont peut-être préféré se concentrer sur des éléments plus directement applicables.
• Impact sur la compréhension de Keynes :
• Si ces chapitres ont réellement été omis, cela pourrait expliquer pourquoi certaines idées de Keynes sur les dimensions sociales et psychologiques de l’économie ont été sous-estimées ou négligées dans les interprétations ultérieures.
4. Impact de ces omissions sur la pensée économique :
• Réduction de l’analyse socioculturelle :
• L’absence de ces chapitres aurait limité la reconnaissance de Keynes comme un penseur intégrant les dimensions sociales et culturelles à l’économie.
• Cela aurait renforcé une lecture plus technocratique de son œuvre, centrée sur les outils macroéconomiques tels que la politique budgétaire et monétaire.
• Réémergence de ces idées :
• Des économistes contemporains comme George Akerlof ou Robert Shiller, en développant l’économie comportementale et la psychologie économique, revisitent indirectement ces dimensions omises chez Keynes.
5. Controverse et incertitudes :
• Absence de confirmation académique :
• Aucun consensus académique clair ne confirme explicitement la suppression de chapitres liés à l’énergie collective.
• Cependant, certains manuscrits de Keynes, y compris ses correspondances et notes personnelles, indiquent qu’il portait un intérêt aux influences socioculturelles.
• Influence ultérieure :
• Les idées omises ou sous-explorées par Keynes dans ses publications ont ouvert la voie à des disciplines comme l’économie comportementale ou les études sur l’inconscient collectif en économie.
Conclusion :
Keynes a joué un rôle révolutionnaire en intégrant les facteurs psychologiques dans l’analyse économique, mais l’omission de certains chapitres (si elle est avérée) aurait réduit la portée de sa pensée sur les dynamiques collectives. Ces dimensions pourraient avoir approfondi la compréhension des interactions entre les forces sociales et les décisions économiques, offrant une vision encore plus large et riche de son héritage intellectuel.
(3). Phil Stutz et Barry Michels développent dans leurs écrits, notamment dans The Tools, l’idée que la créativité est essentielle pour la transformation intérieure. Ils explorent ce concept à travers des outils psychologiques pratiques qui permettent aux individus de dépasser leurs blocages et d’accéder à leur plein potentiel. Voici une analyse approfondie de cette idée et de son articulation dans leur travail :
1. La créativité comme force intérieure :
• Idée principale : La créativité n’est pas seulement un talent artistique, mais une capacité innée chez tout être humain pour imaginer et construire une vie meilleure.
• Transformation intérieure :
• Ils soulignent que pour surmonter les obstacles personnels, il faut générer des solutions nouvelles, souvent en allant au-delà des schémas habituels de pensée.
• La créativité est perçue comme une connexion avec une force intérieure qui transcende les peurs, les doutes et les limitations.
2. Les cinq outils pour stimuler la créativité et la transformation :
Dans The Tools, ils proposent des techniques concrètes pour encourager cette transformation. Ces outils reposent sur l’idée que la créativité est un processus actif de changement :
• L’outil de la réversion (The Reversal of Desire) :
• Aide à dépasser la peur et l’évitement.
• En confrontant directement l’inconfort, les individus libèrent leur créativité pour avancer.
• L’outil de l’activation (The Active Love Tool) :
• Encourage à remplacer les ressentiments par l’amour actif.
• Cela libère l’esprit pour imaginer des relations et des perspectives plus positives.
• L’outil de l’énergie intérieure (The Inner Authority Tool) :
• Stimule la confiance en soi, qui est une clé pour prendre des risques créatifs et explorer de nouvelles possibilités.
• L’outil de l’audace (The Grateful Flow) :
• Fait appel à la gratitude pour réduire la négativité et ouvrir l’esprit à des idées innovantes.
• L’outil de la connexion (Jeopardy Tool) :
• Rappelle l’importance de vivre pleinement et de s’engager activement dans le présent, catalysant ainsi la créativité et la transformation.
3. La créativité comme réponse au blocage :
• Les blocages psychologiques :
• Ils identifient des émotions comme la peur, le doute et l’apathie comme des ennemis de la créativité.
• Ces blocages empêchent la transformation intérieure en maintenant les individus dans des schémas de pensée limités.
• Solution : La créativité active :
• Loin d’être passive, la créativité est une pratique consciente qui permet de sortir des impasses émotionnelles et mentales.
4. La créativité comme connexion avec une force supérieure :
• Perspective spirituelle :
• Michels et Stutz voient la créativité comme un lien avec une force transcendante ou divine.
• Cette force intérieure guide les individus vers des solutions innovantes et les inspire à évoluer.
• Action dans la vie quotidienne :
• Ils insistent sur le fait que la créativité ne se manifeste pas uniquement dans l’art, mais aussi dans des actions simples comme la résolution de conflits ou la prise de décisions audacieuses.
5. La transformation intérieure par l’action :
• Passer de la pensée à l’action :
• Selon eux, la transformation intérieure ne peut se produire que lorsque les idées créatives sont mises en pratique.
• Chaque action, même petite, nourrit le processus de transformation.
• Créer un nouveau soi :
• La créativité permet de réinventer son identité et d’écrire sa propre histoire en réponse aux défis de la vie.
6. Exemples pratiques :
• Situation : Une personne coincée dans une routine insatisfaisante.
• Outil proposé : L’outil de la réversion, pour transformer la peur du changement en une opportunité de croissance.
• Situation : Un conflit relationnel.
• Outil proposé : L’outil de l’amour actif, pour imaginer une manière différente de répondre au ressentiment.
7. Conclusion :
Pour Phil Stutz et Barry Michels, la créativité est le catalyseur de la transformation intérieure. En cultivant des pensées et des actions innovantes, les individus peuvent dépasser leurs blocages émotionnels, trouver des solutions à leurs problèmes et vivre une vie plus épanouissante. La créativité devient ainsi un chemin vers une vie plus riche, plus authentique et plus alignée avec ses aspirations profondes.